L’alimentation est urbaine
L'alimentation est urbaine
Explorez l'intersection entre les systèmes alimentaires urbains et les fonctions de la ville, les éléments interconnectés qui façonnent la manière dont les aliments entrent dans les espaces urbains, les traversent et en sortent.
Pourquoi l'alimentation est-elle urbaine ?
Dans les villes africaines, les systèmes alimentaires sont dynamiques, façonnés par les marchés, les infrastructures, la gouvernance et les structures sociales qui, ensemble, ont un impact sur l’accès à la nourriture, la sécurité et la santé. La visualisation de ces systèmes imbriqués met en évidence l’influence des villes sur la disponibilité, le choix et l’accessibilité des aliments, ainsi que la manière dont ces facteurs affectent la qualité de vie des habitants et les possibilités de croissance, en particulier pour les jeunes. Chaque élément clé, des vendeurs de rue aux marchés en passant par les services de santé et les infrastructures, révèle le rôle essentiel que jouent les villes dans la mise en place de systèmes alimentaires urbains durables, équitables et résilients.
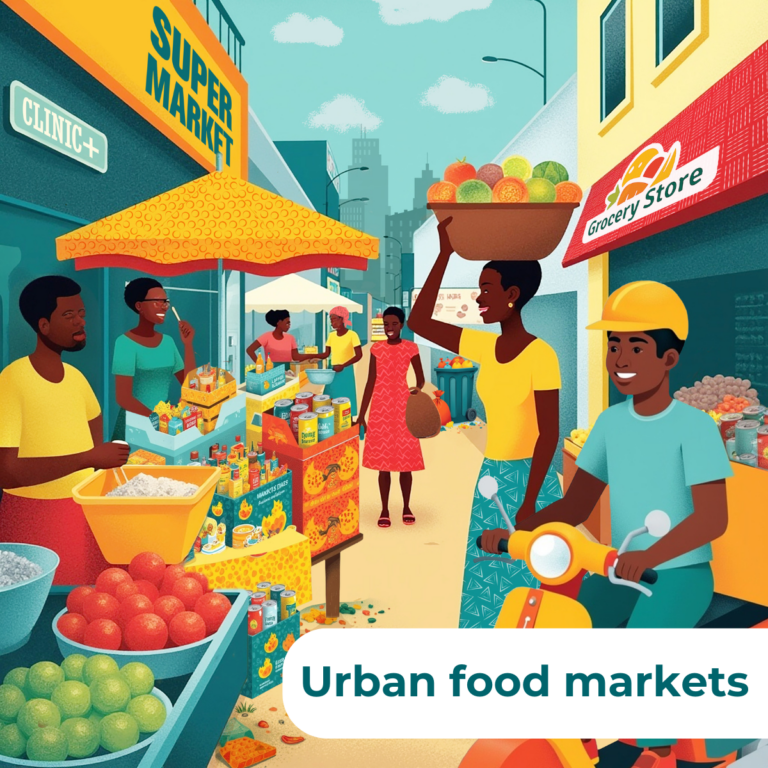
Marchés alimentaires urbains
Les marchés alimentaires urbains constituent l’un des principaux nœuds de l’infrastructure sur laquelle repose le système alimentaire urbain en Afrique. Les marchés alimentaires urbains sont des établissements locaux de l’économie alimentaire qui proposent une variété de produits alimentaires et non alimentaires, offrent des possibilités d’emploi et se caractérisent par un service personnalisé, des prix négociables et des rôles culturels et sociaux importants. Plus de 80 % des aliments consommés dans les villes en expansion du continent passent par ces marchés alimentaires. Les propriétaires de marchés, les agriculteurs, les vendeurs et les clients participent tous aux marchés alimentaires urbains, dont le chiffre d’affaires est estimé entre 200 et 250 milliards d’USD par an en Afrique.
Ces systèmes urbains de vente au détail de produits alimentaires ont tendance à être très informels, les petits vendeurs de produits alimentaires constituant une source vitale de nourriture pour la plupart des résidents urbains en Afrique et fournissant des moyens de subsistance à beaucoup d’entre eux, en particulier les femmes. Cependant, ces centres animés entraînent souvent des embouteillages, créant des perturbations qui suscitent des discussions sur la délocalisation des marchés. La pression foncière joue également un rôle, car ces marchés occupent des espaces urbains de premier ordre qui peuvent susciter des intérêts de réaménagement qui ne tiennent pas compte de la sécurité nutritionnelle.
Les gouvernements locaux ont généralement un mandat clair en matière de gestion des marchés et de réglementation du commerce alimentaire informel. Elles ont également un mandat d’aménagement du territoire et de zonage qui devrait dicter comment et où les supermarchés peuvent s’étendre. Grâce à ces deux éléments, elles ont le pouvoir de façonner les systèmes alimentaires urbains.
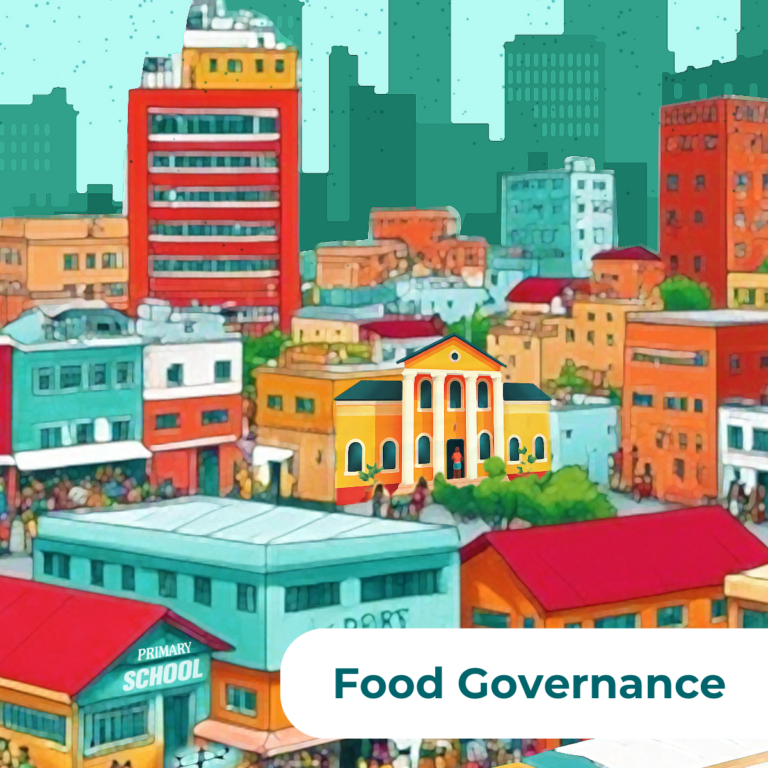
Gouvernance alimentaire
Les modes actuels de gouvernance alimentaire doivent faire l’objet d’une réflexion approfondie ; les systèmes alimentaires urbains doivent être activement gouvernés et non pas laissés au hasard. Les mandats des gouvernements locaux permettent la gouvernance alimentaire, en particulier la gestion des processus, des acteurs et des services du système alimentaire au sens large, tels que la vente d’aliments, les infrastructures, le soutien au marché, l’eau et l’assainissement, les services d’appui et les transports. Toutefois, l’absence d’une gouvernance ciblée peut avoir des conséquences graves et à long terme sur la durabilité et l’efficacité des systèmes alimentaires urbains.
Outre la gouvernance formelle, les systèmes informels jouent un rôle crucial, en particulier sur les marchés alimentaires. Les associations de commerçants, par exemple, contribuent à la gestion des espaces de marché, à la résolution des conflits et à la gestion des déchets – des services que les gouvernements locaux ne sont pas toujours en mesure de fournir de manière adéquate.
Les gouvernements nationaux jouent également un rôle, notamment en réglementant les prix des denrées alimentaires et en accordant des subventions, ce qui a un impact direct sur l’accès aux denrées alimentaires et leur prix. Ce rôle devrait être reconnu comme faisant partie du paysage plus large de la gouvernance alimentaire.
Dans certaines villes, les chefs traditionnels peuvent avoir autant, sinon plus, d’influence que les gouvernements locaux, en particulier lorsqu’il s’agit de l’attribution de terres pour les marchés. Les chefs traditionnels sont souvent les gardiens des terres, ils déterminent l’emplacement des marchés et influencent l’accès à la nourriture d’une manière que les gouvernements locaux ne peuvent pas forcément.

Systèmes de santé
L’une des principales conséquences d’une mauvaise gouvernance alimentaire en milieu urbain est l’impact négatif sur la santé, qui affecte les personnes tout au long de leur vie de diverses manières. Ces problèmes contribuent à la transition nutritionnelle, c’est-à-dire à l’abandon des régimes alimentaires traditionnels au profit d’aliments plus transformés et moins sains, ce qui entraîne de graves conséquences pour la santé et des implications sociétales à long terme. Cette situation est vécue différemment par les divers groupes de la ville, les habitants des quartiers informels étant confrontés aux défis les plus importants et aux conséquences les plus néfastes. L’une des principales caractéristiques de la transition alimentaire en milieu urbain n’est pas simplement le manque de nourriture, mais aussi le fait que les mauvais types d’aliments sont de plus en plus présents en trop grande quantité. Les villes sont donc confrontées au double fardeau de la faim, de la malnutrition et de l’obésité.
Dans de nombreux pays, les ministères de la santé sont responsables des campagnes de santé et de nutrition, mais ils n’ont pas forcément de mandat direct sur les systèmes alimentaires. Ce décalage peut entraver la coordination des efforts visant à résoudre efficacement les problèmes de santé liés à l’alimentation. Par exemple, en Afrique du Sud, où la moitié des adultes sont aujourd’hui en surpoids ou obèses, la stratégie nationale de santé continue de qualifier les maladies non transmissibles (MNT) liées à l’alimentation de « maladies liées au mode de vie », ce qui implique que les mauvais choix alimentaires sont une question de mode de vie individuel, plutôt que de les reconnaître comme un problème de pauvreté lié à un accès limité à des aliments abordables et nutritifs.

Enfants et jeunes
La population jeune croissante des villes africaines est confrontée à des défis importants, notamment la pauvreté et le chômage, qui pèsent sur la qualité de l’alimentation des ménages en raison de la forte dépendance à l’égard d’un nombre réduit de personnes actives. Si certains jeunes qui en ont les moyens peuvent suivre les tendances alimentaires façonnées par la publicité qui promeut les aliments transformés et les fast-foods comme étant à la mode, cela peut avoir des conséquences négatives sur leur santé. Cependant, l’engagement des jeunes dans le système alimentaire commence bien plus tôt, en particulier au cours des 1 000 premiers jours de la vie, période critique où un accès insuffisant à des aliments nutritifs peut avoir des répercussions profondes sur le développement à long terme et le potentiel futur. Les jeunes peuvent devenir de puissants agents de changement s’ils sont mieux éduqués et s’ils participent activement à l’élaboration de systèmes alimentaires urbains plus sains.
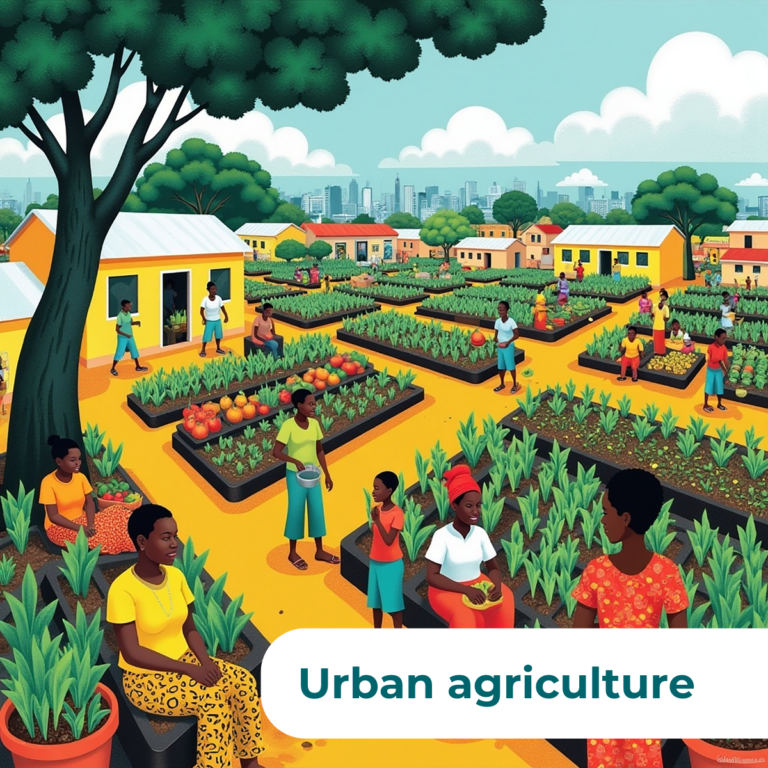
Agriculture urbaine
La culture alimentaire urbaine fait référence à la production d’aliments, tels que les cultures et le petit bétail, à l’intérieur des frontières urbaines. Cela inclut des efforts tels que les jardins communautaires et scolaires, l’agriculture dans les arrière-cours et sur les toits, ainsi que d’autres méthodes innovantes pour cultiver des aliments dans des espaces limités. Si l’agriculture urbaine peut compléter les sources d’alimentation rurales et parfois améliorer la nutrition, son impact varie considérablement d’une ville à l’autre. Par exemple, dans des villes comme Le Cap, Windhoek, Tamale et Lusaka, la production alimentaire urbaine n’a pas contribué de manière significative à l’approvisionnement alimentaire global.
Les appels officiels en faveur de l’agriculture urbaine, même s’ils sont bien intentionnés, peuvent involontairement faire porter la responsabilité de la lutte contre l’insécurité alimentaire urbaine sur les personnes souffrant de la faim et de la pauvreté, au lieu d’inciter les autorités locales à prendre des mesures décisives pour protéger et soutenir les populations vulnérables. En effet, certaines études ont montré que les agriculteurs urbains font partie des habitants des zones urbaines qui souffrent le plus de l’insécurité alimentaire. Pour être efficaces, les efforts en matière d’agriculture urbaine doivent être soutenus par des politiques qui améliorent réellement l’accès à la nourriture, plutôt que d’en détourner la responsabilité.
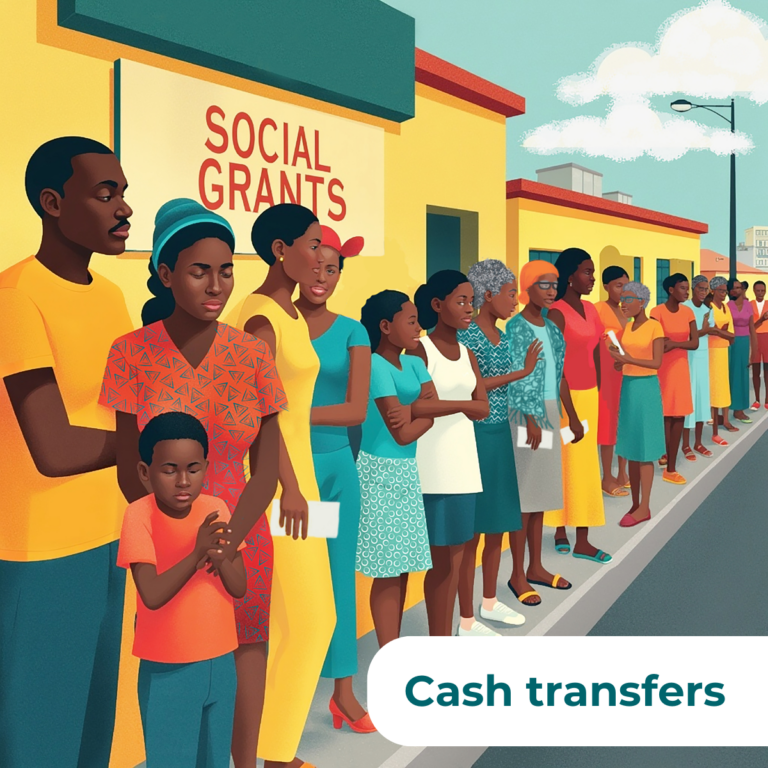
Transferts en espèces
Les aides sociales, proposées par les gouvernements et les organisations non gouvernementales caritatives, sont essentielles pour aider les groupes vulnérables à accéder à la nourriture. Les bons alimentaires, les subventions en espèces et le financement des cuisines collectives améliorent la sécurité alimentaire en apportant un soutien direct aux personnes dans le besoin.
Les aides sociales peuvent prendre de nombreuses formes et s’adresser à différents groupes de la société. Parmi les exemples les plus courants, on peut citer les pensions de retraite pour les personnes âgées, les allocations familiales pour les parents de jeunes enfants et les transferts d’argent d’urgence aux familles à la suite de catastrophes ou de chocs spécifiques.
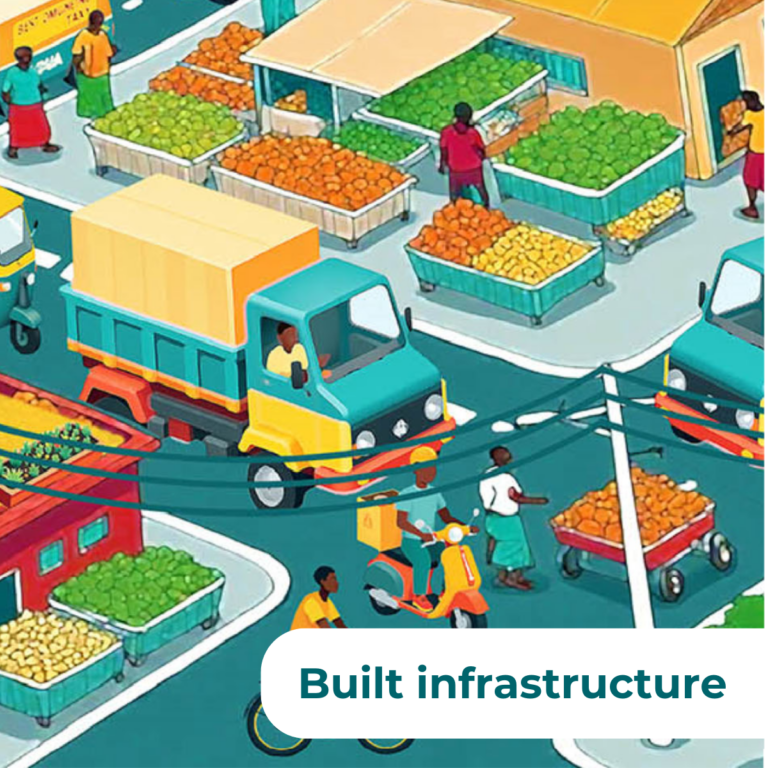
Infrastructures construites
Les infrastructures urbaines – transport, énergie, eau, assainissement et gestion des déchets – déterminent comment, où et quels aliments sont accessibles et consommés. Des systèmes de transport fiables sont essentiels pour une distribution rapide des aliments ; des systèmes médiocres entraînent des retards et une augmentation des pertes de nourriture. L’accès à l’énergie, y compris l’électricité pour la réfrigération et la cuisson, influence les choix alimentaires des ménages, tandis que l’eau propre et l’assainissement sont essentiels à la sécurité alimentaire sur les marchés, dans les foyers et dans les institutions. Une gestion efficace des déchets permet de garder les marchés propres, de réduire les parasites et de protéger la qualité des aliments.
Les collectivités locales sont généralement chargées de mettre en place les infrastructures, alors que les systèmes alimentaires relèvent souvent de la compétence des comtés, des provinces ou des pays. La mise en évidence du lien entre l’alimentation et l’infrastructure peut contribuer à valoriser et à justifier le rôle des collectivités locales dans le soutien aux systèmes alimentaires.
Des recherches récentes confirment que l’accès aux infrastructures est un facteur important de la sécurité alimentaire dans les villes africaines.
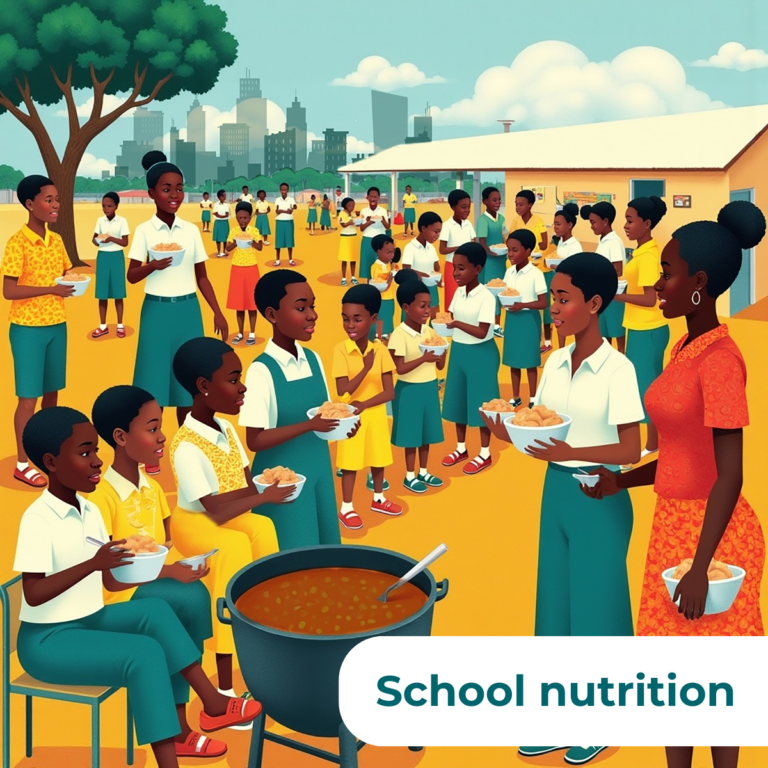
Alimentation scolaire
Les services sociaux, tels que les programmes de repas scolaires, jouent un rôle essentiel dans l’aide apportée aux enfants issus de ménages à faibles revenus. En fournissant des repas nutritifs à l’école, ces programmes améliorent non seulement la nutrition des enfants, mais encouragent également l’assiduité scolaire, contribuant ainsi à prévenir l’abandon scolaire chez ceux qui pourraient autrement quitter l’école en raison de l’insécurité alimentaire.
Actuellement, la distribution de repas scolaires est relativement faible dans la plupart des villes africaines, mais l’importance croissante accordée à la fourniture de repas aux enfants dans les crèches et les écoles commence à changer cette situation. En raison des coûts élevés associés à ces programmes, les efforts visant à étendre la couverture des repas scolaires sur le continent nécessitent une collaboration étroite entre les gouvernements locaux et nationaux ainsi que les parents, les donateurs et les acteurs du secteur privé.

Vendeurs ambulants
Les vendeurs de rue s’installent le long des principaux axes de transport, des routes et dans les quartiers informels, offrant commodité et accessibilité. Ils sont souvent préférés par les résidents à faibles revenus en raison de leurs relations personnelles avec les commerçants, de leur offre de nourriture dans des unités plus petites et, parfois, de leurs possibilités de crédit. En apportant la nourriture directement dans les zones résidentielles et les centres de transport, ces vendeurs réduisent la nécessité d’effectuer des déplacements coûteux vers des marchés plus importants. |

Aide alimentaire directe
Les filets de sécurité sociale jouent un rôle crucial en aidant les individus et les familles à gérer les risques et à faire face à la volatilité économique, en offrant une protection contre la pauvreté et l’inégalité tout en créant des opportunités. Ces programmes apportent un soutien ciblé aux groupes vulnérables, notamment les personnes âgées, les personnes handicapées, les enfants orphelins et d’autres populations défavorisées, en leur garantissant l’accès aux biens et services essentiels et en prévenant l’indigence.
Parmi les exemples de filets de sécurité sociale, on peut citer les colis alimentaires, l’aide alimentaire d’urgence fournie par des organisations telles que la Croix-Rouge ou le Programme alimentaire mondial, ainsi que d’autres formes d’aide aux communautés dans le besoin. Ceci met en évidence la distinction entre les filets de sécurité sociale et les subventions, les transferts d’argent et les autres services sociaux.
Si les programmes d’aide alimentaire d’urgence sont souvent gérés par de grandes organisations internationales, les résidents locaux et les ONG jouent également un rôle important dans la fourniture d’une aide alimentaire locale aux communautés vulnérables. Les efforts locaux sont souvent menés par des bénévoles et offrent un soutien très rentable en raison de leur nature simple et décentralisée.

Supermarchés
Les supermarchés se développent dans de nombreuses villes africaines et constituent une source importante d’approvisionnement en produits alimentaires – principalement des produits transformés et importés, mais certains proposent également des produits frais. Bien qu’ils puissent évincer les petits commerces informels, il est courant de voir des vendeurs informels opérer à proximité ou juste à l’extérieur. Les supermarchés font leur apparition dans certaines régions, mais restent inaccessibles à une grande partie de la population urbaine et ne desservent pas nécessairement la majorité.
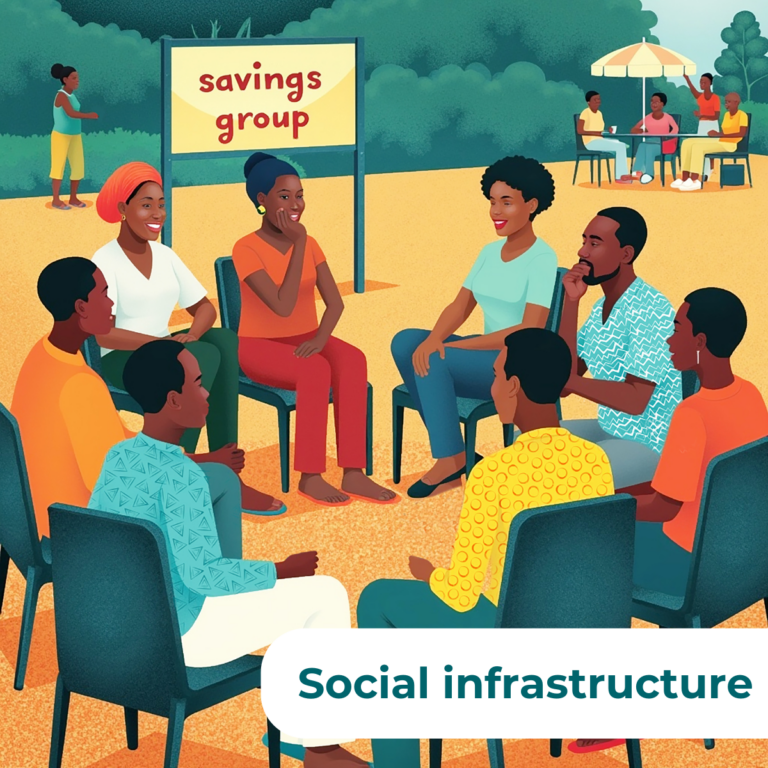
L’infrastructure sociale joue un rôle crucial dans le soutien aux membres des sociétés urbaines inéquitables. Ces structures, telles que les groupes d’épargne et de crédit, permettent aux acteurs des systèmes alimentaires à petite échelle d’accéder à des capitaux essentiels et aux membres de mettre en commun leurs ressources pour acheter de la nourriture – généralement des denrées non périssables – en vrac pour leurs ménages. Bien qu’ils soient essentiels au fonctionnement des systèmes alimentaires urbains, ces systèmes informels sont souvent négligés, sous-évalués et laissés à l’écart des considérations politiques officielles.

Systèmes logistiques
Les marchés de gros métropolitains font office de centres de distribution alimentaire, recevant les marchandises des régions environnantes et approvisionnant les marchés formels et informels de la ville.






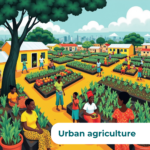








Infrastructures sociales